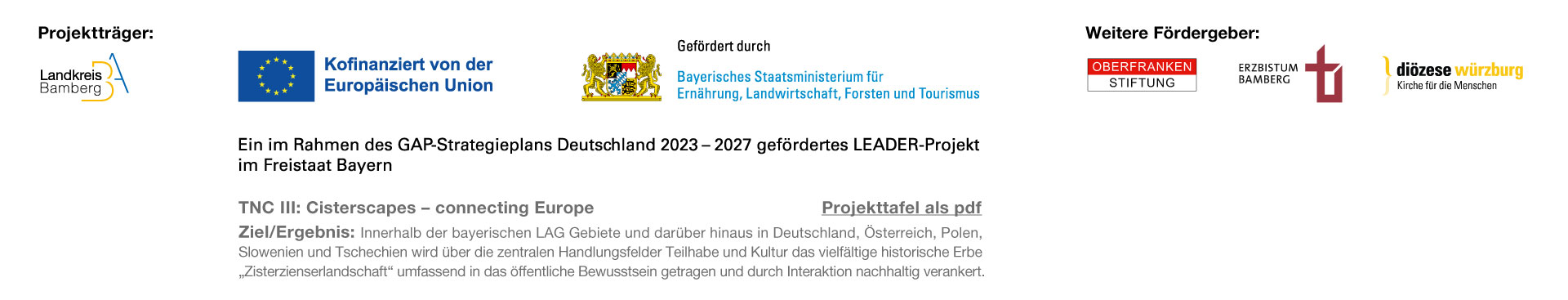Zwettl
Date de fondation : 1138 (numéro d’ordre 133 selon Janauschek)
Date de dissolution : /
Filiation / monastère mère : Morimond / Stift Heiligenkreuz
Monastère fille : /
Hadmar Ier de Kuenring fonda l’abbaye de Zwettl après que la Vierge Marie eut montré le lieu de fondation à l’aide d’un chêne verdoyant en hiver. Zwettl présente encore aujourd’hui un paysage culturel exemplaire, qui est représenté de manière idéale dans le livre de fondation du début du 14ème siècle comme un tour avec le monastère comme centre - entouré d’un anneau de granges. Le paysage est marqué par la gestion des étangs et la sylviculture.
Version audio
Événements en cours
Derniers messages
Le paysage culturel
La fondation du monastère cistercien de Zwettl par la famille ministérielle des Kuenringer remonte à 1137/38. La fondation en tant que filiale de l’abbaye d’Heiligenkreuz, fondée quelques années plus tôt, concrétisait des projets qui avaient été poursuivis depuis longtemps par la famille fondatrice. Le soutien du projet par l’évêque de Passau ainsi que par les abbés d’Ebrach, Heiligenkreuz et Morimond lors du chapitre général de Cîteaux témoigne des liens internationaux du monastère depuis ses débuts.
L’emplacement du nouveau monastère dans la zone de la « forêt du nord » (qui s’étendait jusqu’à la forêt du Haut-Palatinat au début du Moyen Âge) s’inspire des directives formulées par l’Ordre, la proximité de la zone d’habitation de la ville de Zwettl ainsi que du croisement de deux grandes voies de communication (Böhm- et Polansteig) présentant des parallèles évidents avec d’autres fondations.
Au sein du phénomène culturel européen des « paysages cisterciens », le paysage du monastère de Zwettle occupe une place particulière en ce qui concerne sa conservation et sa documentation. La représentation de l’événement de fondation, appelée « Umritt » (au cours de laquelle le bien de la fondation était parcouru à cheval par le fondateur et l’abbé), réalisée au début du 14ème siècle, constitue la première représentation d’un paysage monastique cistercien. Représenté dans le manuscrit dans le style d’une carte du monde, il confirme la volonté des moines de transformer la topographie dans le sens des idéaux de l’ordre, qui prévalait dans toute l’Europe. Une grande partie des granges et des éléments paysagers représentés ici caractérisent encore aujourd’hui le paysage monastique vivant.